XIXe siècle
-
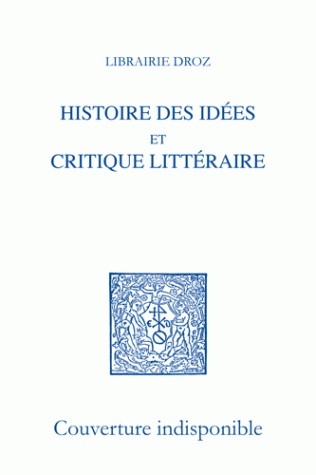
Par un étrange renversement, c'est avec des textes que nous ne lisons presque plus que Chateaubriand s'est acquis auprès de ses contemporains la gloire sans pareille qui fut la sienne, alors que les Mémoires d'outre-tombe, mal acceuillis à leur publication en 1848, sont aujourd'hui unanimement considérés comme un ouvrage unique et une référence essentielle pour notre modernité, non seulement dans sa réflexion sur l'Histoire, mais aussi dans sa mise en œuvre d'une poétique d'une grande complexité et complètement originale.
Table des matières: Marc FUMAROLI, Histoire et mémoire.; Damien ZANONE, Les mémoires et la tentation du roman: L'exception épique des mémoires d'Outre-Tombe. ; Pierre RIBERETTE, Mémoires par lettres.; Béatrice DIDIER, Voyages croisés.; Pierre GLAUDES, Une idée fixe qui vient du ciel: le sublime dans les Mémoires d'Outre-Tombe.; Jean-Claude BONNET, Les formes de célébration.; Hans Peter LUND, Les artistes dans les mémoires d'Outre-Tombe.; Francesco ORLANDO, Temps de l'histoire, espace des images.; Michael SHERINGHAM, La mémoire-palimpseste dans les mémoires d'Outre-Tombe.; Agnès VERLET, Epitaphes vagabondes.; Philippe BERTHIER, Mémoire pour rire.; Ivanna ROSSI, La rhétorique allusive.; Jean-Marie ROULIN, La Clausule dans les mémoires d'Outre-Tombe.; Fabienne BERCEGOL, Poétique de l'anecdote.; Antoine COMPAGNON, Poétique de la citation.; Jean-François PERRIN, Figures de lecture; Bernard DEGOUT, Le journal du "Sacre"; Jean-Paul CLEMENT, La Fascination du politique; Jacques LECARME, Ministres autobiographes; Jean Claude BERCHET, Chateaubriand et le théâtre du monde.; Index
-
-

Ce livre, le premier à réunir des études sur les différentes vocations de Mérimée, invite à redécouvrir une œuvre dont l’originalité a partie liée avec son inscription dans plusieurs domaines culturels. A la redécouvrir, parce que, peu fréquentée par les chercheurs pendant la dernière trentaine d’années, elle est restée captive d’idées reçues séculaires – «sécheresse», «froideur», position «réactionnaire» – qui continuent encore à en fausser l’approche. Aussi les auteurs de ce livre se proposent-ils d’élaborer une image nouvelle de Mérimée, adaptée à la sensibilité de notre époque. A travers les évocations des travaux de l’inspecteur général des Monuments historiques, d’une fécondité insoupçonnée du public, des écrits de l’historien connus seulement des initiés, à travers la relecture de la production de l’écrivain, telle que l’organisent son imaginaire passionné et ses courageux paris esthétiques, se dessine le profil d’une œuvre ouverte sur l’avenir par la pluralité de ses perspectives, prête à se renouveler dans les confrontations que sollicite son intransigeante singularité.
Ont collaboré à cet ouvrage Françoise Bercé, Yves-Marie Bercé, Pierre Brunel, Michel Cadot, Scott Carpenter, Jacques Chabot, David Charles, Ludmila Charles-Wurtz, Anne Clancier, Valérie-Angélique Deshoulières, Antonia Fonyi, Isabelle Gabolde, Joël Gilles, Francis Marcoin, Claude Millet, Thierry Ozwald, Daniel Pageaux, Paule Petitier, Georges Poisson, Olivier Poisson, Gwenhaël Ponnau, Anne-Marie Reboul, Michel Sandras. Publié avec le concours de l’Université Paris-7.
-
-
Pour comprendre une religion, il faut penser dans la langue de ceux qui l’ont vécue. Jean Rudhardt applique cette méthode, en étudiant un champ limité de la religion grecque. Noms communs thémis signifie à peu près l’équité, hôrai, les saisons, eunomia, la bonne organisation, diké, la justice, eiréné, la paix. Ces mots nomment aussi des déesses. Les modernes sont enclins à les tenir pour des notions divinisées. L’étude des textes nous donne une autre vision des choses. Les noms de ces divinités ne signifient pas des notions mais des sentiments: ceux que l’homme éprouve quand s’imposent à lui les exigences de la justice ou de la paix.
-
-
-
-

C'est à une étude approfondie et magistrale de l'œuvre complète d'Alfred de Vigny que se livre André Jarry, recueil après recueil, poème après poème, récit après récit. Il retrace ainsi la courbe de l'œuvre, œuvre dans un premier temps éparpillée, jusqu'au jour où elle se risque à frôler le noyau fou de la personnalité. Les équilibres, dès lors, basculent et se succèdent, mutation lente qui dure ce que durent, et l'œuvre, et la vie. De Stello à Daphné, des poèmes du "délaissement" à la résurrection de la Maison du Berger, les étapes sont exemplaires, et les conquêtes décisives souvent enfouies au cœur du texte. La carrière, à la fin, a révélé son unité. L'œuvre, dans sa progression, est bien l'équivalent d'une cure analytique (réussie). Si Freud a tendance à juger des œuvres littéraires ou artistiques en fonction de leur contenu plutôt que de leur aspect formel, la lecture psychanalytique récente, dont André Jarry est ici un représentant éminent, renverse en quelque sorte la thèse, et juge opportun de faire retour à la beauté du texte. Le grand bénéfice de ce commentaire est de nous procurer, au-delà de l'analyse formelle des textes, un déchiffrement psychanalytique qui dégage le poétique, c'est-à-dire permet d'entendre la ligne mélodique sur fond de tensions et de détentes alternées, selon ce jeu syncopé qui caractérise le mouvement même de l'analyse.
-
David ARNOLD,
Cyprian BLAMIRES,
Karel BOSKO,
Marcel COTTIER,
Gérard DANOU,
Frank DIKÖTTER,
Max ENGAMMARE,
Jean-Claude FAVEZ,
Yasmina FOEHR-JANSSENS,
Laurence GUIGNARD,
Timothy HARDING,
Mark HUNYADI,
Romano LA HARPE,
Arielle MEYER,
Alessandro PASTORE,
Michel PORRET,
Beat RÜTTIMANN,
Fernando VIDAL,
Jean WIRTH
Moyen Âge chrétien, Europe moderne et contemporaine, sociétés coloniales: ces études originales apportent un regard interdisciplinaire sur cet objet central des sciences humaines qu'est le corps, abordé ici sous la thématique de la violence concrète et de son imaginaire social ou littéraire. Religieuses, pénales, militaires, concentrationnaires, pathologiques et aussi thérapeutiques: les violences du corps trouvent une actualité singulière en cette fin de XXe siècle. Elles font parfois écho, après les camps nazis, aux guerres civiles ou à la purification ethnique, laboratoires de l'anéantissement corporel et de la déshumanisation. Textes de: David Arnold; Cyprian Blamires; Karel Bosko; Marcel Cottier; Gérard Danou; Frank Dikötter; Max Engammare; Jean-Claude Favez; Yasmina Fœhr-Janssens; Laurence Guignard; Timothy Harding; Mark Hunyadi; Romano La Harpe; Arielle Meyer; Alessandro Pastore; Michel Porret; Beat Rüttimann; Fernando Vidal; Jean Wirth.